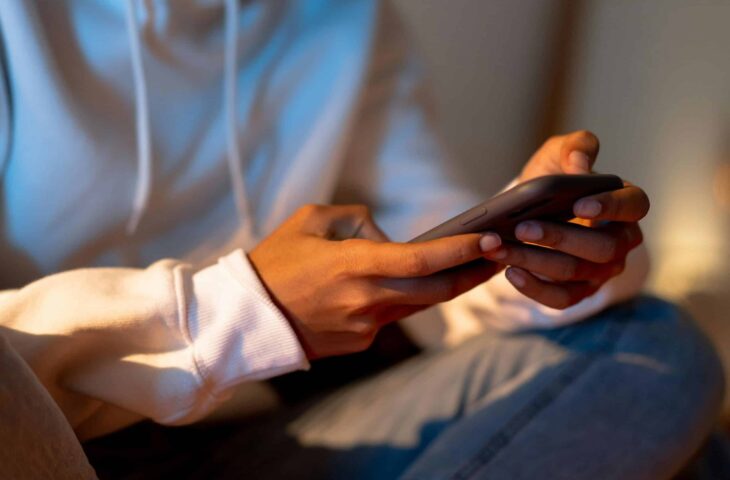
Pexels - Cottonbro
On ouvre nos réseaux “juste deux minutes”.
Puis on défile, on clique, on scrolle… sans vraiment savoir comment on en est arrivé là.
Ce n’est pas un manque de volonté.
C’est le résultat d’un design pensé, calibré, optimisé pour capter l’attention. À tel point que certains de ses créateurs eux-mêmes le regrettent aujourd’hui.
Comprendre ces mécanismes, c’est déjà se protéger. C’est exactement ce que rappelle la psychologue Nora Monnehay dans notre podcast Corps et Fracas, lorsqu’elle parle des comportements addictifs comme d’une “machine à sous émotionnelle” : un petit geste… et on espère une récompense.
Le jour où notre attention est devenue un business
Au début des années 2000, alors que Facebook, YouTube et plus tard Instagram prendront d’assaut nos écrans, les plateformes comprennent que leur valeur ne dépend pas seulement du nombre d’inscrits, mais du temps que chacun passe connecté. Le “temps d’attention” devient une ressource, une monnaie, un gisement exploitable.
Facebook introduit le bouton « Like » en 2009, pensé (entre autres choses) par l’ingénieur Justin Rosenstein. Un simple geste, presque anodin, mais qui crée une boucle de gratification sociale instantanée. Instagram, en 2010, pousse encore plus loin ce réflexe : publier une photo, recevoir un like, ressentir une micro-récompense. Quant à YouTube, l’introduction du lecteur automatique en 2012 supprime volontairement le moment de décision où l’utilisateur pourrait s’arrêter.
Puis vient l’ère des algorithmes. Les réseaux ne se contentent plus de diffuser du contenu : ils modèlent notre fil selon nos clics, nos pauses, nos hésitations. Plus le contenu est personnalisé, plus il est difficile d’en sortir.
Ceux qui ont conçu… puis dénoncé
Ce qui rend tout cela fascinant (et un peu inquiétant), c’est que plusieurs de ceux qui ont construit ces systèmes en dénoncent aujourd’hui les effets.
Tristan Harris, ancien designer éthique chez Google, parle d’un design capable de “pirater l’esprit humain”. Sean Parker, cofondateur de Facebook, reconnaît que la plateforme exploite la dopamine pour encourager la validation sociale. Aza Raskin, l’inventeur du scroll infini, regrette une innovation qui “dévore la vie de millions de personnes”. Leur message converge : rien n’est accidentel.
Les techniques qui nous accrochent
Les réseaux sociaux exploitent des mécanismes bien identifiés en psychologie. Le plus puissant est celui de la récompense variable : on effectue un geste (scroller, rafraîchir, ouvrir une notification) dans l’espoir d’obtenir quelque chose : un like, un message, un commentaire. Parfois il ne se passe rien. Parfois oui. Et cette incertitude suffit à rendre l’action addictive.
Le scroll infini, inventé pour empêcher les pauses naturelles, amplifie ce phénomène. Pas de signal d’arrêt, pas de fin de page, pas de respiration. On glisse d’un contenu à l’autre sans même remarquer le temps qui passe.
Les réseaux sociaux ont aussi emprunté beaucoup au monde du jeu vidéo. Sans jamais le dire, ils ont glissé des mécanismes de gamification partout : les streaks de Snapchat transforment une simple conversation en défi quotidien, le compteur de likes ou d’abonnés devient presque un tableau de scores, et le fil de TikTok fonctionne comme une suite infinie de “niveaux” à découvrir. Chaque interaction agit comme une petite récompense : un like, une nouvelle vue, un commentaire qui apparaît au bon moment. L’utilisateur n’est plus simplement spectateur ; il joue, sans même réaliser qu’il est en train de jouer.
Pour renforcer cet effet, les algorithmes observent tout ce que nous faisons. Ils apprennent à partir de nos pauses, de nos accélérations, des contenus qui nous touchent, de ceux qui nous agacent, de l’heure exacte où nous sommes le plus vulnérables à l’ennui ou à la distraction. Avec ces micro-données, ils deviennent capables de prédire ce qui nous retiendra le plus longtemps. Nous n’avons plus affaire à un fil neutre, mais à un miroir très précis de nos faiblesses et de nos désirs.
Les notifications, enfin, sont devenues plus subtiles qu’à l’époque de la simple pastille rouge. Elles vibrent au bon moment, affichent des rappels formulés pour créer un léger FOMO (Fear Of Missing Out, “la peur de rater quelque chose”), ou surgissent lorsqu’un algorithme estime que nous avons “un moment disponible”. Certaines ne signalent même pas un événement réel, mais suggèrent un retour possible : “Vous pourriez aimer ceci”, “De nouvelles tendances vous attendent”. Il ne s’agit plus de transmettre une information, mais de relancer la boucle et de nous ramener dans l’application à un instant calculé.
Reprendre la main sans renoncer à la technologie
Se protéger ne signifie pas se couper du monde. Il s’agit plutôt de recréer de l’intention dans nos usages.
Voici quelques idées pour s’en rapprocher :
- Désactiver les notifications non essentielles : moins de signaux, moins de réflexes.
- Sortir le téléphone de la chambre : c’est le moment où l’on est le plus vulnérable.
- Créer des moments sans écran : 20 minutes le matin, 20 minutes le soir.
- Placer les applis les plus “addictives” dans un dossier : une petite friction de plus pour casser l’automatisme.
- Se demander simplement “pourquoi je l’ouvre ?”
On revendique ainsi, notre capacité à choisir quand et comment utiliser les réseaux sociaux.